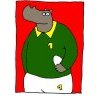Le gouvernement présente son plan de réduction des risques liés aux pesticides
Le site Actu-environnement.com relate une communication portant sur le plan interministériel 2006-2009 de réduction des risques liés aux pesticides et qui vient d’être présentée. Mais pour certains, ce plan est sans envergure, et n’aura pas de réel impact.

Les pesticides, produits visant à la destruction de certains organismes vivants jugés nuisibles (animaux, végétaux, micro-organismes) sont utilisés depuis de nombreuses années dans différents domaines, comme l’agriculture mais aussi la voirie pour l’entretien des infrastructures routières et ferroviaires, le traitement du bois ou bien encore divers usages privés (jardinage, traitement des locaux...). Avec 76 100 tonnes de substances actives commercialisées en 2004, la France est le premier consommateur de pesticides en Europe et le 3e consommateur mondial, derrière les Etats-Unis et le Japon.
C’est dans ce contexte, et alors que le marché des pesticides a enregistré une hausse en 2005 après six années de baisse, que le ministre de l’Agriculture Dominique Bussereau et la ministre de l’Ecologie Nelly Olin ont présenté, en Conseil des ministres, une communication sur le plan interministériel 2006-2009 de réduction des risques liés aux pesticides.
S’inscrivant dans le cadre du Plan national santé environnement de 2004 ainsi que dans le volet agriculture de la stratégie française pour la biodiversité de novembre 2005, l’objectif de ce plan consiste à obtenir une réduction de 50 % des quantités vendues de substances actives les plus dangereuses.
Pour ce faire, il prévoit qu’une zone non traitée d’au moins cinq mètres le long des cours d’eau soit rendue obligatoire afin de limiter les transferts de pesticides vers l’eau. Des incitations fiscales et la diffusion de références techniques devraient encourager également les pratiques et systèmes de production qui emploient moins de pesticides. D’autre part, la vente aux jardiniers amateurs de produits ne portant pas la mention ’’ Emploi autorisé dans les jardins’’ devrait être interdite et les contrôles, lors de la distribution et de l’utilisation de ces produits, renforcés.
D’autres actions composent ce plan, comme l’amélioration des procédures d’évaluation des produits et de la qualité des pulvérisateurs grâce à un contrôle périodique obligatoire, et le renforcement de la gestion des risques liés à la distribution et à l’utilisation des produits phytosanitaires en assurant notamment une traçabilité des ventes de pesticides.
Le plan préconise également de développer la formation des professionnels et de renforcer l’information et la protection des utilisateurs. Ainsi, la formation des professionnels, distributeurs ou applicateurs agréés de produits phytosanitaires, intègrera un volet relatif aux risques sanitaires et environnementaux. Les médecins en milieu rural seront formés aux risques liés aux pesticides. Les distributeurs de produits seront encouragés à mettre en vente, avec leurs produits, les équipements de protection individuelle les mieux adaptés.
Les deux ministres ont souhaité aussi, en Conseil des ministres, améliorer la connaissance et la transparence en matière d’impact sanitaire et environnemental, et évaluer les progrès accomplis. De manière à réaliser ces deux objectifs, un observatoire des résidus de pesticides rassemblera et valorisera les informations sur la présence des pesticides dans l’environnement, afin de caractériser l’exposition de la population et des écosystèmes, et d’améliorer l’information du public, notamment par l’ouverture d’un site Internet*. Un comité de suivi de l’efficacité du plan, ouvert à la société civile, sera également mis en place pour évaluer les progrès accomplis. Il s’appuiera sur des indicateurs synthétiques de risque.
Par ailleurs, des opérations de récupération et d’élimination des produits phytosanitaires seront étendues en 2006 aux stocks d’arsenite de soude, produit hautement toxique, désormais interdit.
Enfin, le ministre de l’Agriculture, Dominique Bussereau et la ministre de l’Ecologie, Nelly Olin, ont précisé en Conseil des ministres que la France défendrait auprès de la Commission européenne l’application dans la réglementation communautaire du principe de substitution de ces produits par d’autres présentant le moins de risques sanitaires et environnementaux possible. Ces produits seront taxés au titre de la redevance perçue par les agences de l’eau.
Cependant pour le Mouvement pour le droit et le respect des générations futures (MDRGF), ce plan est sans envergure et n’aura pas de réel impact, puisqu’il ne prévoit pas de véritable objectif de réduction d’utilisation. Il est seulement évoqué une réduction d’utilisation des substances les plus dangereuses, cancérigènes, mutagènes et toxiques, sans préciser les catégories concernées, et en tolérant leur utilisation pour certains usages, note-t-il dans un communiqué. François Veillerette, Président du MDRGF et administrateur français du réseau Pesticide Action Network Europe, déplore que ce plan fasse la part belle à l’agriculture raisonnée, au détriment de l’agriculture biologique et des systèmes de production intégrée, pourtant véritablement efficaces pour supprimer ou réduire l’utilisation des pesticides de synthèse. Quant à la mise en place de bandes enherbées de 5 m pour limiter les transferts, l’association estime cette mesure insuffisante, au regard du rapport de l’INRA de 2005.
Ce plan intervient alors qu’une enquête menée par l’association CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) dans 6 enseignes pendant le mois de mai montrait que, même si l’étiquetage s’était amélioré (seulement 2% d’irrégularités sur les mentions obligatoires) les pesticides étaient pourtant en voie de banalisation. Selon l’enquête, 50% des distributeurs présentent des pesticides hors des rayons dédiés à ces produits. En outre, la CLCV s’inquiétait du fait que les emballages soient séduisants, même pour les produits les plus dangereux, et qu’un magasin sur deux propose des offres promotionnelles sur ces produits. De plus, sur les 21 marques analysées seulement 3 font apparaître sur leur emballage les coordonnées d’un centre anti-poison, signalait la CLCV. L’association demandait donc que sur tous les produits soit indiqué le numéro de téléphone du centre anti-poison, que ces produits soient clairement désignés comme des produits à risque, et que les plus dangereux d’entre eux ne soient plus disponibles en libre-service dans les magasins.
La contamination des fruits et légumes par des pesticides s’est d’ailleurs à nouveau aggravée en Europe et a atteint près de la moitié des aliments végétaux, selon des chiffres publiés par le MDRGF récemment. Ces données portant sur l’année 2004 en comparaison avec 2003 ont été transmises à l’association au cours d’une réunion d’un groupe de travail fin mai à Corfou en Grèce par la Commission européenne.
En outre, les échantillons présentant plusieurs résidus différents représentaient 23,4% du total, chiffre en augmentation de 2% par rapport à 2003, indique encore l’association. Les laboratoires ont trouvé 197 pesticides différents dans les échantillons analysés, contre 185 l’année précédente. À l’inverse, un rapport de la Commission européenne de novembre 2005, communiqué à l’AFP par l’Interprofession des fruits et légumes (Interfel), soulignait le bon niveau de sécurité sanitaire des fruits et légumes en Europe...
* www.observatoire-pesticides.gouv.fr
Article rapporté avec l’aimable autorisation de la direction d’Actu-environnement.com.
1 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON